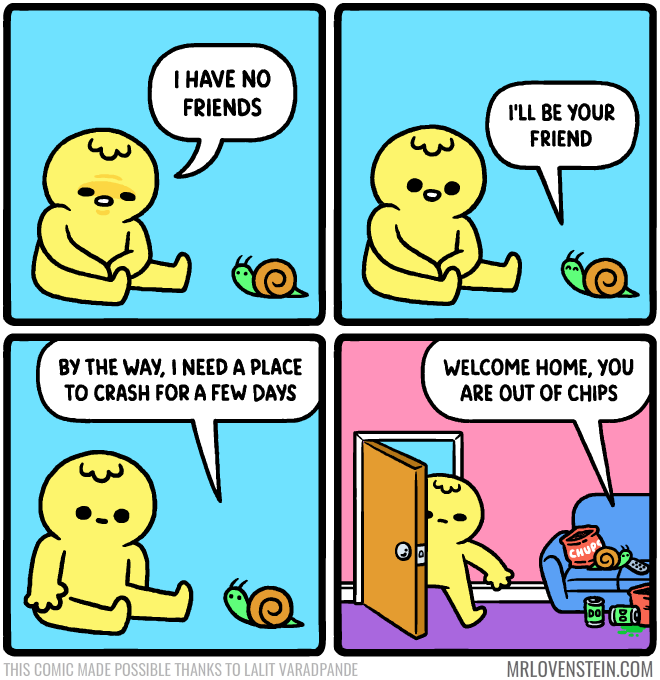Je m'inscris weshhh.
Meilleurs messages postés par Egon
-
Quel est ton âge musical ?posté dans Parler Musique
Un site se propose de vous dire à quelle génération vous appartenez en termes de goûts musicaux. Pour se faire, il faut que vous ayez un compte Spotify puisque ça se calcule à partir de ça.
"Pour rappel, les générations sont définies comme suit:
GÉNÉRATION Z: né en 1994 ou après, âgé de moins de 25 ans
GÉNÉRATION Y: né entre 1981 et 1994, entre 25 et 38 ans
GÉNÉRATION X: né entre 1965 et 1980, entre 39 et 54 ans
BABY-BOOMER: né entre 1946 et 1964, entre 55 et 73 ans"Pour accéder au site, cliquez ici.
Selon mon compte Spotify (qui ne représente qu'une infime partie de ce que j'écoute, vu que je me sers surtout de Youtube), mon âge musical est de 52 ans, donc de la génération entre la mienne et celle de mes parents. Ça me surprend parce que j'écoute quand même pas mal de choses qui ont le vent en poupe dans notre génération (rap, electro...).
Et vous, quel est votre âge musical ? Il y a-t-il quelqu'un qui arrive à avoir un âge musical synchro avec son âge réel ?
-
RE: Nintendo Switchposté dans Parler Jeux
@Godzapon @Hornet @joejon @jool @Drakkaru @KypDurron
Si je vous propose vendredi vers 21h30, c'est ok ?
-
RE: Le topic défouloir (quand t'as envie de rager)posté dans Carte blanche
@Godzapon Comme je te comprends puisque je galère encore avec le même colis depuis deux semaines maintenant ! Le coup du "non mais on a pas pu le livrer aujourd'hui parce que le destinataire est fermé, on le reprogramme pour demain" m'a achevé étant donné que c'est livré à un particulier. Je ne songe plus à aller brûler leurs entrepôts, je crois que je vais vraiment le faire d'ici la fin de la semaine. è_é
EDIT : Troisième appel au service client pour apprendre que le colis a été transmis à la poste aujourd'hui qui va le relivrer demain. J'ai du coup demandé à ce qu'ils le déposent dans la boîte aux lettres si la personne n'est pas présente parce que ça commence un peu à être lassant au bout d'un moment hein. Y'a plus qu'à croiser les doigts très forts pour qu'ils soient capables de faire ce pour quoi on les paye. <<
-
RE: Rap/Hip-hopposté dans Parler Musique
J'ai toujours bien aimé le rap. J'ai commencé à en écouter quand j'avais pas plus de 10 ans, d'ailleurs à l'époque de ma pré-adolescence, j'étais même fan d'Eminem, je passais mon temps à écouter en boucle l'album qu'un des amis de mes parents m'avait filé : The Eminem Show avant de passer mon argent de poche dans ses albums précédents.
J'ai longtemps écouté surtout du rap US et puis en grandissant je suis revenue aussi vers le rap FR. J'ai tendance à préférer les textes porteurs d'un message (ce que l'on range généralement sous les termes de "rap conscient"). J'aime bien IAM, Sniper, Orelsan, Gringe, Georgio, Kery James, Medine, MC Solaar, Lucio Bukowski, Diamond Deuklo chez les français par exemple ; et en US, ça tape du côté d'Eminem, Run DMC, Coolio, Hopsin, Kid Cudi, Macklemore, Redman...
Puis, il y a aussi K-os, un rappeur canadien, Curse, un rappeur allemand. Voilà ce qui me vient à l'esprit sur le moment !
-
RE: Votre waiting listposté dans Parler Jeux
@jool a dit dans Votre waiting list :
Vous faites comment quand vous avez plusieurs jeux à faire?
C'est toi qui demandes ça alors que tu en as toujours 50 en cours et que t'arrives même à en poncer une bonne partie ? é_è
J'ai plein de jeux en attente depuis des semaines, des mois :
-
Red Dead 2 : pas encore touché mais ça va certainement être le prochain que je vais lancer sur la PS4.
-
Far Cry 5 : arrêté il y a un mois maintenant et je pense pas le continuer pour le moment, trop long et j'ai envie de toucher à autre chose.
-
Spiderman : À peine entamé parce qu'on y avait joué surtout quand ma sœur était chez ouam et j'ai pas eu l'occasion d'y rejouer entre temps. Faut que je lui accorde un peu plus d'attention parce que le côté "se balader en sautant de toit en toit avec la toile", c'était plutôt fun et les combats à la Batman en amélioré, ça envoyait aussi du pâté (par contre, j'avais envie de dire "taggle" à chaque fois à Peter Parker car son humour est un peu trop lourdingue).
-
Days Gone : téléchargé à l'occasion d'une promo mais pas encore testé.
-
Celeste : Acheté depuis mai je crois mais je n'ai pas encore pris le temps de m'y mettre, j'attends d'avoir écoulé un peu les jeux PS4 pour m'y mettre.
-
Super Smash Bros Ultimate : J'ai absolument pas fini les modes aventure/esprits, faudrait que je le fasse et que je teste un peu plus les combats en ligne histoire de pas avoir un niveau trop caca pour jouer avec les autres membres.
-
BOTW : j'ai revendu mon exemplaire il y a un bon moment parce que je n'étais pas entrée dans le jeu au bout d'une vingtaine d'heures. Je songe à piquer l'exemplaire de ma sœur pour lui redonner une chance.
Et ne parlons même pas de Borderlands 3 et Link's Awakening qui viennent de s'ajouter à la liste et que j'ai pas encore réussi à caser. Surtout que j'ai aussi Borderlands 2 que j'aimerais bien refaire parce que Handsome fucking Jack siouplaît.
Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas le courage de faire la liste complète (et aussi bien ordonnée que la tienne).
@jool a dit dans Votre waiting list :
Guitar Hero 2/3/4/5/6 , finis bien-sûr, mais pour maîtriser les chansons en expert, il faut en passer du temps à faire et refaire les solos de dingue!
Oui, alors je veux bien ton adresse pour me rendre de ce pas chez touah et pouvoir retoucher à du Guitar Hero ! °_°
-
-
RE: Rap/Hip-hopposté dans Parler Musique
@canaille-sympa C'est peut-être parce que les teutons ont souillé les plages normandes, ça lui a pas plu. °_°
-
RE: Nintendo Switchposté dans Parler Jeux
@Hornet Je vois pas le rapport avec moi ! è_é
(En vrai j'ai hésité à le tester parce que le résumé m'a bien fait marrer).
-
RE: Vous avez carte blanche !posté dans Carte blanche
@LeaPierce Il n'y en a pas effectivement mais tu peux le créer !
-
RE: Battles du cinéma (4ème édition) - Peri est le vainqueur !posté dans Animations Cinéma
Les deux sont cool mais comme il faut faire un choix : Je vote pour Lapin.
-
RE: Rap/Hip-hopposté dans Parler Musique
@canaille-sympa C'est un des albums que j'ai le plus écoutés cette année, ahah.
-
RE: Votre liste d'achats/d'envies/de souhaitsposté dans Parler Jeux
Si j'ai encore un peu d'argent, je crois que je vais prendre Crypt of the Necrodancer...sinon bah j'attendrai octobre.
-
RE: Rap/Hip-hopposté dans Parler Musique
@canaille-sympa Bonne question. Parce que les sujets évoqués me parlent pas mal, parce que c'est un album plus posé, plus mature, en adéquation avec l'âge d'Orelsan.
-
RE: Votre liste d'achats/d'envies/de souhaitsposté dans Parler Jeux
@jool Ça marche ! Comme ça je pourrai en profiter pour bouger un peu plus. °_°
-
RE: Le topic défouloir (quand t'as envie de rager)posté dans Carte blanche
Ouhla, je viens de recevoir un message passif agressif de la coloc qui est partie il y a deux semaines parce que je ne lui ai pas encore réglé les 12 € d'internet because ça m'était sorti de la tête.
J'aime pas du tout qu'on me parle de manière méprisante pour une broutille, elle s'est mangée une réponse hyper sèche en retour et par esprit de contradiction je serais tentée de ne pas lui régler vu le foutage de gueule (en vrai je vais le faire mais elle a plutôt pas intérêt de m'adresser la parole à l'avenir).